Depuis les temps les plus anciens, l’homme a cherché à transcender sa condition, à élever certains de ses semblables au rang de figures quasi-divines. Ce besoin de glorification, d’idéalisation, traverse les civilisations, les cultures et les époques. Il s’exprime dans les rites païens de l’Antiquité, les cérémonies religieuses, les grandes manifestations populaires et même dans les arènes modernes des compétitions sportives. Mais que signifie réellement l’apothéose ? Que révèle-t-elle sur l’âme humaine ? Ce mot, issu du grec « apotheôsis » (ἀποθέωσις), désigne littéralement l’acte de « devenir un dieu ». En explorant ses racines étymologiques et son utilisation historique, nous découvrirons comment cette notion a évolué au fil des siècles et quelles implications elle porte pour notre époque.
Apothéose (action d’élever au rang de dieu)
Dans la Rome antique, chaque ville élevait au rang de dieu son fondateur ou ses héros. Cette coutume se prolonge dans l’Église catholique, qui « sanctifie » des humains pour en faire des « intercesseurs entre Dieu et les hommes ». Une pratique qui pourrait trouver ses racines dans cette tradition antique. Toutefois, cela constitue un dévoiement de l’Évangile et de la doctrine biblique, pour laquelle il n’y a qu’un seul intercesseur entre Dieu et les hommes : Jésus-Christ.
L’apothéose était aussi marquée par des célébrations publiques, notamment le passage des héros ou vainqueurs sous des arcs de triomphe. Ces monuments, conçus pour glorifier leurs exploits, symbolisaient l’élévation de l’homme au rang presque divin. Une glorification de l’homme qui trouve des échos jusque dans nos sociétés modernes. Ainsi, l’apothéose d’un individu consiste à l’élever au rang de demi-dieu. Une pratique symbolique que l’on retrouve encore aujourd’hui, par exemple dans le geste de remettre les clefs d’une ville à une personnalité.
Une apothéose moderne : les sportifs
Abordons le « sport », un terme qui étymologiquement signifie « hors des portes », car il se pratiquait à l’extérieur des villes. Les compétitions sportives représentent des confrontations non sanglantes — du moins, en principe. Certaines civilisations, comme les Mayas, pratiquaient le « pok ta pok », ancêtre du football, où le vainqueur était sacrifié en l’honneur des dieux.
Dans l’arène — mot qui signifie sable —, les sports servaient d’augure : on interprétait les résultats comme des présages. Cette dimension dépasse les temps anciens et subsiste aujourd’hui dans les grands stades modernes. Comme l’a souligné Umberto Eco, le football peut devenir un véritable opium des masses, où les sons, les chants et les cris des supporters captivent les foules et les rendent perméables à la manipulation collective. La ferveur dépasse souvent le simple cadre du sport pour atteindre un niveau quasi-religieux.
À notre époque, cette symbolique perdure sous une autre forme : les sportifs sont parfois élevés au rang de demi-dieux, vénérés par leurs fans. Il n’est pas rare que ces héros modernes gagnent en une année des sommes que leurs parents peinaient à accumuler en une vie. Ce phénomène, souvent empreint d’idolâtrie, traduit une exagération presque choquante, surtout au regard des sacrifices que ces admirateurs sont prêts à faire pour soutenir leurs idoles. Cette glorification, orchestrée par des médias et des intérêts économiques, agit comme une forme de manipulation des masses, détournant souvent l’attention des enjeux plus profonds.
L’apothéose révolutionnaire
La Révolution française a aussi produit ses apothéoses humaines, dans un esprit résolument antéchrist. L’exemple le plus frappant est sans doute l’épisode où une actrice, symbolisant la « Raison », fut introduite, nue, à cheval, dans la cathédrale Notre-Dame transformée en « Temple de la Raison ». Cet événement marque une tentative explicite de remplacer l’adoration de Dieu par celle de l’homme.
L’humanisme, dans ce contexte, devient une inversion : l’homme n’est plus vu comme une créature créée pour glorifier son Créateur, mais comme le centre de toute chose, cherchant à se glorifier lui-même. Ce mouvement idéologique continue d’influencer les cultures modernes, où la recherche de la transcendance est souvent réorientée vers des figures humaines ou des idéaux purement matérialistes.
Rachetons le mot
Mais le seul qui ait été réellement élevé au rang de Dieu, c’est Jésus-Christ. Lui seul :
- A donné sa vie pour sauver les hommes.
- Est descendu aux enfers, où il a libéré les captifs.
- A reçu les clefs de la mort et du séjour des morts.
- Est digne d’être honoré comme Dieu, non par une reconnaissance populaire, mais par la puissance de son sacrifice et de sa résurrection.
En considérant cette vérité, nous devons nous réapproprier le sens profond de l’apothéose : non pas une exaltation exagérée des hommes, mais la reconnaissance de celui qui, seul, est digne d’être honoré comme Dieu.
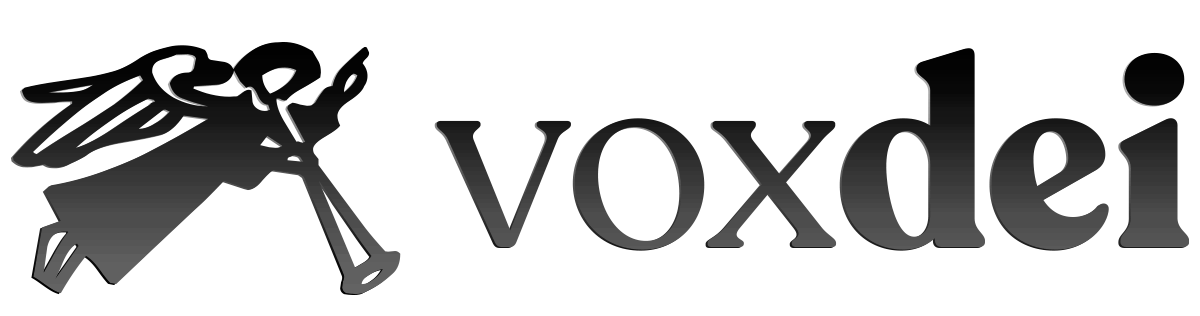

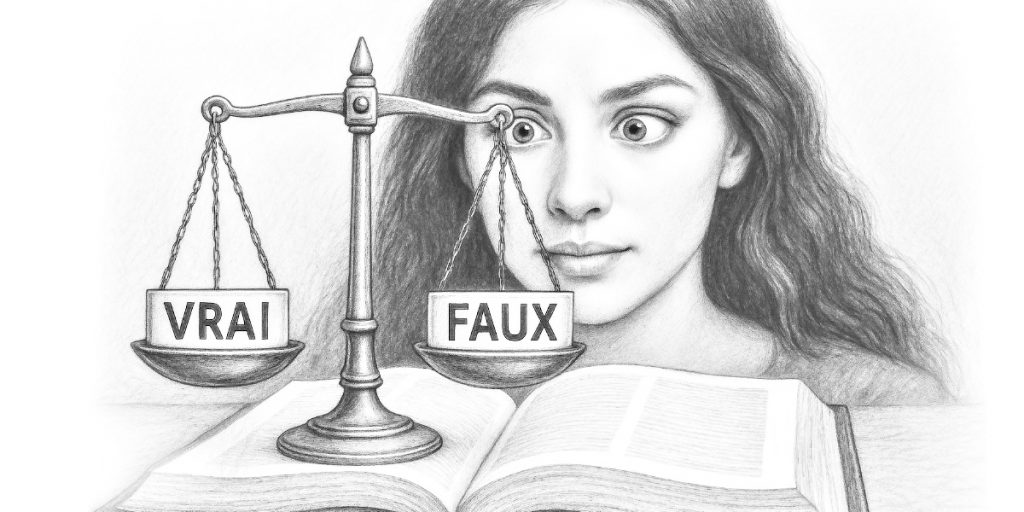
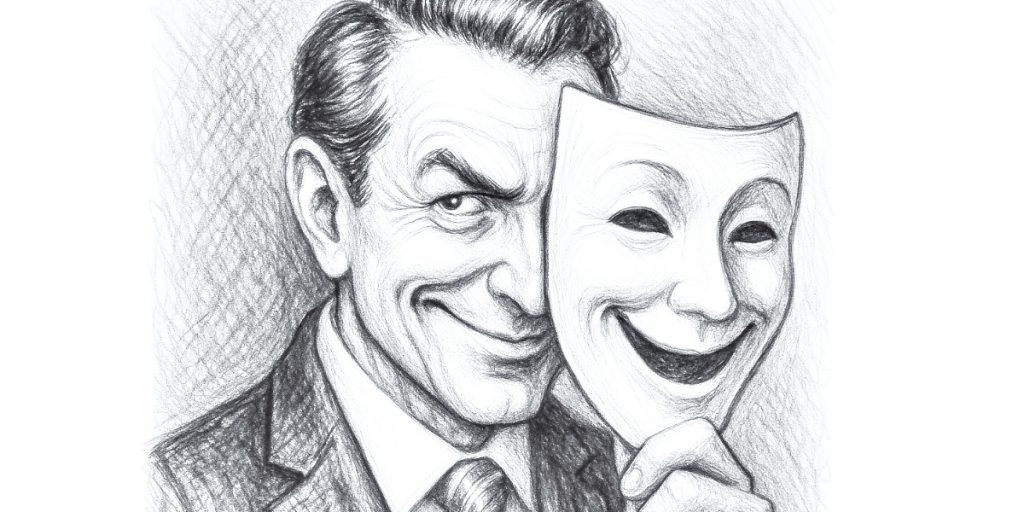



[…] Apothéose (voxdei) […]