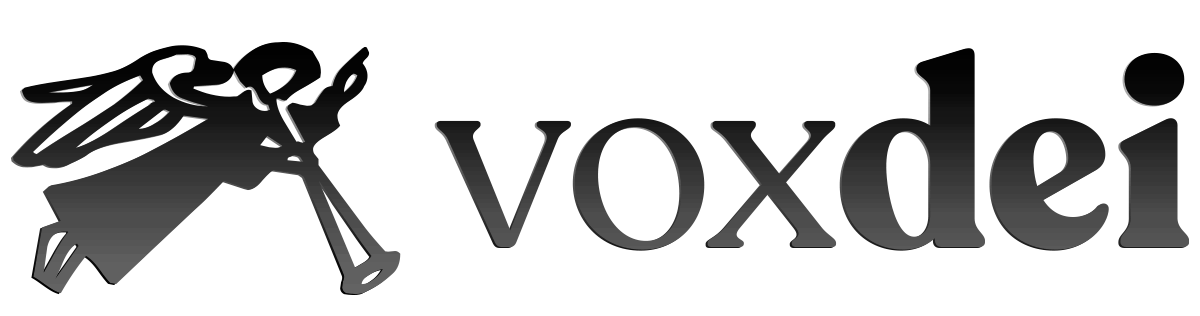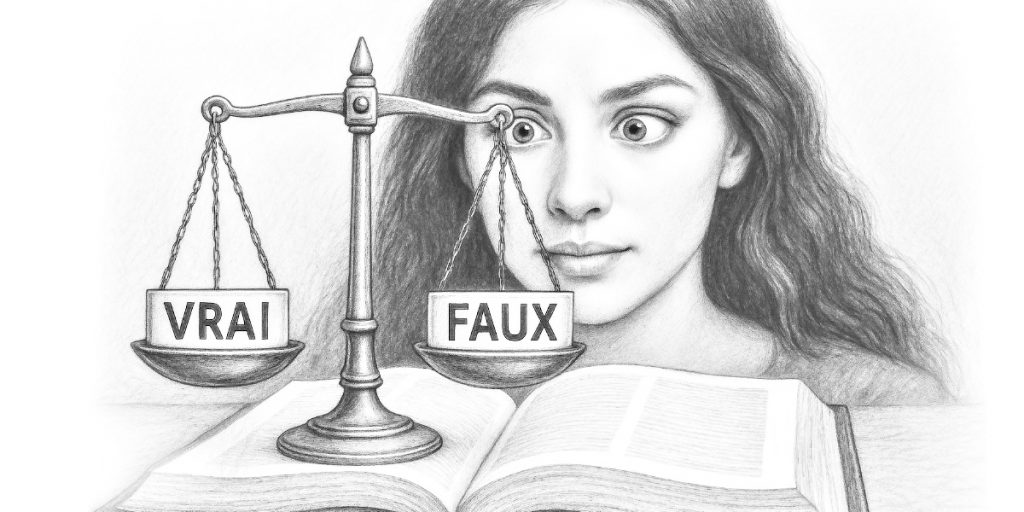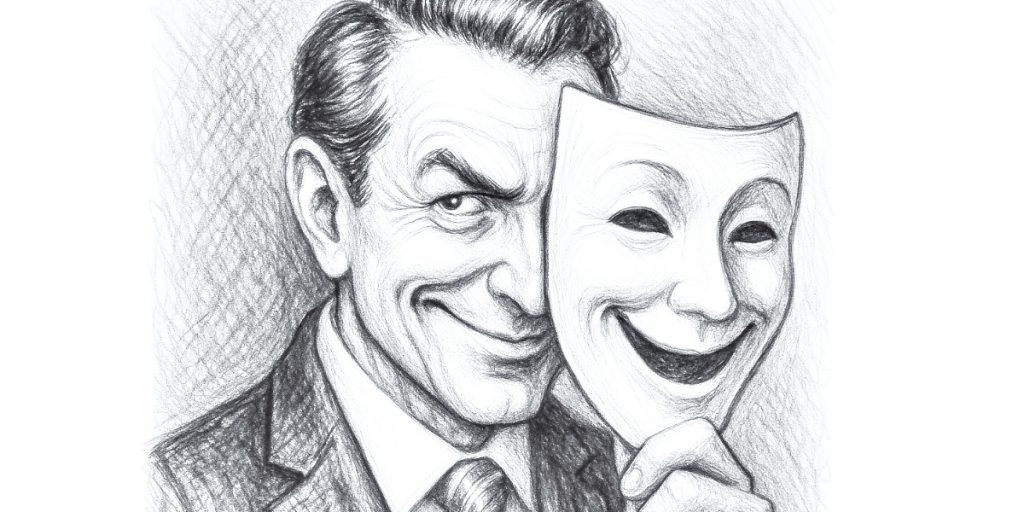Le mot canon, dérivé du grec kanón, signifie « règle » ou « norme ». Dans les Écritures, il incarne à la fois la liste des livres inspirés par Dieu et la mesure divine de justice et de droiture. Que ce soit dans la construction du temple, les jugements prophétiques ou la vision de la Jérusalem céleste, le canon reflète une norme infaillible et immuable. Il nous appelle à aligner nos vies sur la vérité parfaite révélée en Jésus-Christ.
Le canon comme règle : une trajectoire droite
Le mot canon vient du grec ancien kanón, signifiant « règle » ou « mesure droite ». Ce terme, associé à la rectitude et à la précision, trouve son illustration dans des usages pratiques comme l’affût de canon, tracé à la règle pour garantir que les projectiles suivent une trajectoire droite. Toute déviation risquait de compromettre l’objectif. Dans le domaine spirituel, ce sens prend une profondeur particulière avec le canon biblique, qui désigne la liste des livres considérés comme inspirés par Dieu. Ces livres, soigneusement choisis, tracent une ligne droite vers la vérité divine, excluant tout ce qui s’en écarte.
Cependant, le canon de la Bible catholique diffère de celui de la Bible protestante. Lors du Concile de Trente (1545-1563), en pleine Contre-Réforme, l’Église catholique a ajouté au canon biblique juif des livres dits deutérocanoniques, absents du canon hébraïque et considérés comme apocryphes par les protestants. Ces ajouts, comme Tobie, Judith ou encore les Maccabées, visaient à justifier certaines doctrines contestées par la Réforme, telles que la prière pour les morts, le purgatoire, l’ascétisme extrême, ou encore le culte des anges. Ces enseignements, étrangers au texte biblique juif originel, ont ainsi trouvé un semblant de justification « biblique » grâce à ces livres.
Pour les protestants, le canon biblique s’en tient aux 39 livres de l’Ancien Testament hébraïque et aux 27 livres du Nouveau Testament, formant une norme infaillible et suffisante pour la foi et la vie chrétiennes. Toute déviation de cette règle droite est perçue comme une altération de la vérité divine. Le canon, dans son sens le plus pur, demeure la règle spirituelle parfaite, orientée vers Dieu et la justice immuable qu’il incarne.
Le droit canon : un pléonasme catholique
Vous allez penser que je tire à « boulets rouges » sur l’Église catholique, mais le terme droit canonique, utilisé pour désigner l’ensemble des lois régissant cette religion, est en soi un pléonasme. Pourquoi ? Parce que le mot canon, par essence, désigne déjà une règle droite, une norme immuable. Le Droit, lorsqu’il est vrai, n’est jamais tordu : il est « droit » par nature, fidèle à la vérité.
Le schisme entre l’Église d’Orient et d’Occident, consommé en 1054 mais dont les racines remontent au IVe siècle, trouve son origine dans des divergences théologiques et des conflits d’autorité entre Rome et Constantinople. L’Église d’Orient, refusant ce qu’elle percevait comme des innovations occidentales, a choisi le nom d’« orthodoxe », du grec orthos (« droit ») et doxa (« opinion » ou « gloire »), affirmant ainsi son attachement à une foi droite et fidèle aux canons des premiers conciles. Être orthodoxe, ce serait donc aligner sa croyance sur la vérité révélée, sans déviation ni compromis – même si au final avec les siècles la seule différence entre les deux branches « ennemies », c’est que l’une vénère des images en 2D et l’autre des statues en 3D…
La règle d’or de Matthieu : l’étalon céleste
Dans l’Évangile de Matthieu (Matthieu 7:12), Jésus énonce la fameuse « règle d’or » : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Cette règle, cette « canne roseau » (car en hébreu le mot pour désigner le roseau est le mot… kaneh) est l’étalon du ciel, un modèle parfait pour mesurer nos actes. Le mot étalon trouve son origine dans l’idée de mesure. Dans les anciens systèmes de pesée, un étalon était une référence exacte, utilisée pour vérifier la justesse des poids. Ici, la règle d’or devient l’étalon de notre foi et de notre justice.
Pourquoi l’or ? Parce qu’il symbolise la foi éprouvée, purifiée comme par le feu (1 Pierre 1:7), une foi précieuse aux yeux de Dieu. Dans le ciel, l’or est sous nos pieds, constituant les pavés de la Jérusalem céleste (Apocalypse 21:21), symbole des épreuves traversées sur terre pour être rendus semblables à Christ. Cependant, Jésus rappelle que « si quelqu’un ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jean 3:5). Cette foi purifiée doit s’accompagner d’une transformation intérieure par l’eau (la Parole et le baptême) et l’Esprit (la sanctification). Sans cette sanctification, nul ne peut voir le Seigneur (Hébreux 12:14) : l’or céleste incarne ainsi la foi victorieuse et la vie renouvelée en Christ.
La règle de six coudées et la mesure divine des actions
Dans la vision du temple d’Ézéchiel, il est écrit : « Il avait une canne pour mesurer, longue de six coudées. » (Ézéchiel 40:5). Cette kaneh shesh amma (canne / roseau de six coudées), utilisée pour mesurer les dimensions du temple, est une norme précise donnée par Dieu lui-même. Une coudée, mesurant environ 48 cm, fait de cette canne une règle de 2,88 mètres. Cette mesure représente la perfection divine, l’exactitude nécessaire pour bâtir un lieu à la gloire de Dieu.
Cette kaneh, cette « canne roseau » n’est pas qu’un simple outil pratique : elle est le symbole de la rectitude divine, de cette droiture parfaite qui doit guider toute construction spirituelle. Elle reflète aussi une exigence pour ceux qui veulent être « mesurés » selon le standard céleste.
Dans l’Apocalypse, une mesure similaire apparaît : la « mesure d’homme » (Apocalypse 21:17), utilisée pour la ville céleste. Pourtant, cette mesure est aussi qualifiée de mesure d’ange, soulignant qu’elle transcende l’humain. Cela rappelle que Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, est l’étalon ultime, celui par qui toutes choses sont jugées droites ou déviantes.
L’homme, un roseau « pensant » ou « penchant » ?
Faisons une digression sur notre roseau mesureur. Blaise Pascal décrit l’homme comme un « roseau pensant », fragile face aux éléments mais doté de la pensée. Cependant, ce roseau peut aussi devenir un roseau penchant, qui se plie au gré des vents de la société. Jésus lui-même pose cette question au sujet de son cousin, Jean-Baptiste : « Qu’êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? » (Matthieu 11:7).
Dans l’Ancien Testament, le roseau est également utilisé pour symboliser la fragilité humaine ou la dépendance mal placée. Le terme hébreu מִשְׁעֶנֶת (mish’enet), qui désigne un bâton ou une canne utilisée comme soutien, en est un exemple marquant. Ce mot est employé dans un contexte métaphorique pour dénoncer la confiance mise dans des appuis illusoires : « Voici, tu te confies en l’Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s’appuie dessus. » (2 Rois 18:21).
Ce roseau cassé d’Esaïe 42:3 illustre la fragilité de certains appuis humains, incapables de soutenir ou de guider – et pourtant le Messie les redressait avec tendresse (Matthieu 12:20) : Jésus-Christ véritable appui, mesure droite et inébranlable, qui ne cède ni face au vent, ni sous le poids de nos faiblesses. Ainsi, le roseau devient une image de choix pour décrire la condition humaine face à la vérité divine !
Les autres mesures bibliques et « Mene, Mene »
Les Écritures regorgent de termes liés à la mesure, chacun révélant un aspect de la justice divine (et pas limitées au domaine physique). Elles révèlent que Dieu applique une norme précise à tout, des dimensions du temple aux intentions les plus profondes des hommes :
- קו (quav) : Une ligne ou corde de mesure, utilisée pour tracer des limites droites ou des directions justes. « J’établirai le droit pour règle (quav) et la justice pour niveau. » (Ésaïe 28:17). Cette image illustre la droiture divine, qui ne tolère ni biais ni compromis.
- חֶבֶל (chevel) : Une corde ou une part, souvent utilisée pour décrire un lot ou un héritage attribué par Dieu. « Une belle part m’a été assignée » (Psaume 16:6). Elle rappelle que tout ce que nous recevons de Dieu est parfaitement mesuré et juste.
- שׁוּר (shur) : Observer ou mesurer dans un sens moral, exprimant l’évaluation attentive de Dieu sur les cœurs et les actes humains.
- Dans Daniel 5:25, la scène est saisissante : une main divine écrit sur le mur du palais de Babylone : « Mene, Mene, Tekel, Upharsin. » Mene : Compté. Les jours du règne de Babylone sont comptés, tout comme le sont nos vies. Tekel : Pesé. « Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. » Ce mot souligne l’exigence divine pour une justice pleine et entière. Upharsin : Divisé. Le royaume de Babylone est fracturé et donné à d’autres.
Rachetons ce mot
Le mot canon, riche de sens spirituel, peut transformer notre vie si nous l’intégrons pleinement :
- Alignons-nous à la mesure divine : Tout dans notre vie doit refléter la règle parfaite de Dieu. Nos paroles, nos actions et nos pensées doivent être mesurées à l’aune de la vérité biblique.
- Recherchons la droiture : Suivons la droiture de la kaneh en refusant les compromis, même face aux vents contraires de notre époque.
- Faisons un examen régulier : À l’image de la balance divine, évaluons nos cœurs à la lumière des Écritures, cherchant à corriger ce qui dévie.
- Comprenons la portée de nos actions : Tout ce que nous faisons a un poids spirituel. Reconnaissons la gravité de nos choix et agissons en conséquence.
- Adorons Christ, la mesure parfaite : Lui seul est la norme ultime. En nous alignant sur sa droiture, nous entrons dans le plan parfait de Dieu.