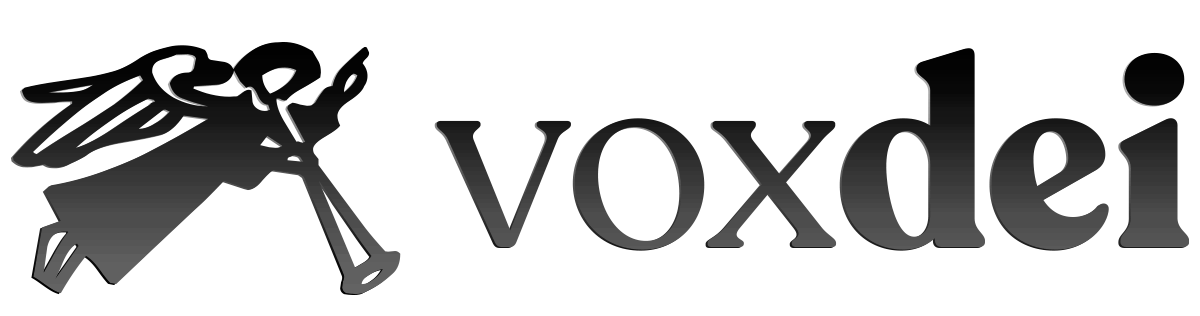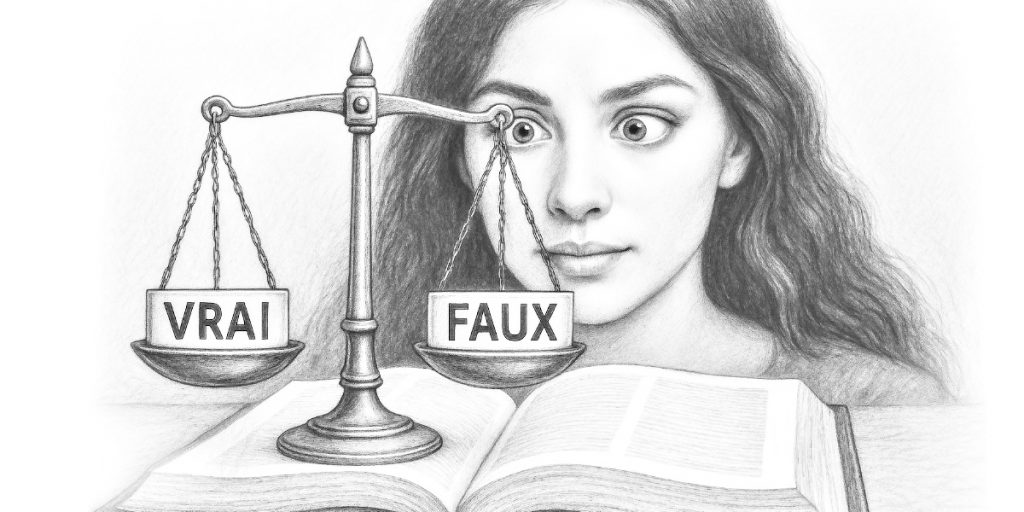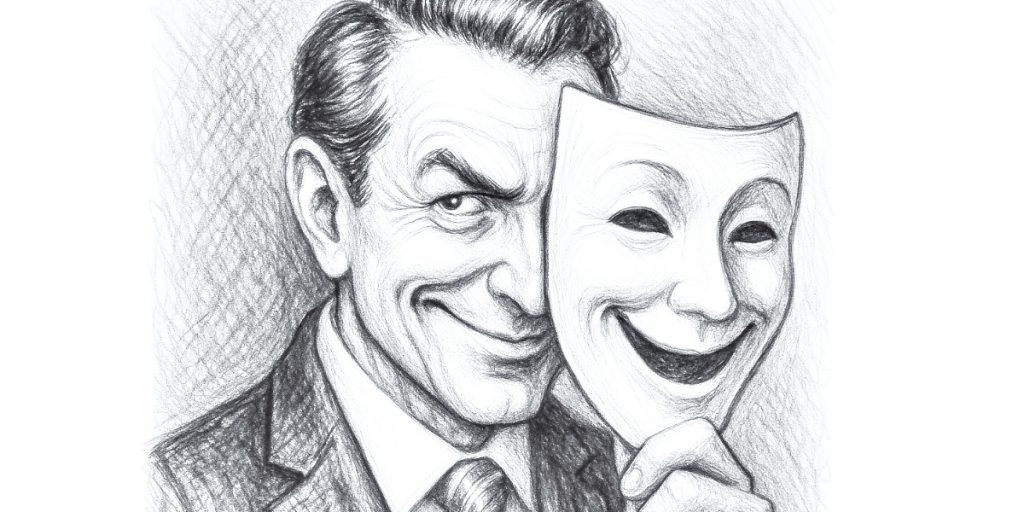Le mot « ennui » évoque souvent une sensation de lassitude ou de désintérêt. C’est Blaise Pascal, le mathématicien et chrétien « charismatique » du 17e siècle qui nous en donne la meilleure définition. Pour lui, l’ennui n’est pas un simple malaise passager mais un reflet profond de la condition humaine. Le mot lui-même, issu du latin in odiare (« se prendre soi-même en haine »), traduit une aversion intérieure, une difficulté à supporter son propre être. Dans ses Pensées, Pascal analyse l’ennui comme l’expression d’une inquiétude existentielle liée au vide intérieur. Cette agitation révèle une quête inaboutie : celle du véritable « lieu » de l’homme, un lieu qu’il ne peut trouver en dehors de Dieu. Cet article explore l’ennui, ses liens avec la notion de diversion et de conversion, et ses résonances avec la sagesse biblique.
L’ennui chez Pascal : un vide existentiel
Pour Pascal, l’ennui est un symptôme de la chute de l’homme, qui a perdu son « véritable lieu ». Il reflète une séparation d’avec Dieu et une incapacité à trouver du repos. L’étymologie du mot ennui, in odiare, évoque cette lutte intérieure, cette haine de soi liée à l’insatisfaction spirituelle. Pascal écrit :
« L’homme ne sait en quel rang se mettre. Il est visiblement égaré et tombé de son véritable lieu, sans pouvoir le retrouver. Il le cherche partout avec inquiétude et sans succès dans des ténèbres impénétrables. » (Pensées, fragment 400)
L’ennui, dans cette perspective, n’est pas seulement un sentiment passager, mais une inquiétude fondamentale qui révèle le besoin d’infini inscrit dans l’homme. Il témoigne de l’incapacité de l’homme à rester seul face à lui-même et à sa propre condition : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. » (Pensées, fragment 139)
Pascal souligne que l’homme préfère fuir cette confrontation avec son vide intérieur, cherchant des distractions qui l’éloignent de sa quête véritable : celle de Dieu.
Diversion : se détourner vers l’extérieur
Le terme « diversion » vient du latin di-vertere, qui signifie « se détourner » ou « tourner ailleurs ». Chez Pascal, la diversion désigne l’ensemble des activités qui détournent l’homme de l’introspection et de sa condition intérieure : plaisirs, distractions mondaines, ambitions. Ces occupations offrent une échappatoire temporaire mais laissent l’homme insatisfait. « Le divertissement nous console de nos misères, et cependant il est la plus grande de nos misères. » (Pensées, fragment 171)
La diversion éloigne l’homme de la vérité de son être et l’empêche de se confronter à son vide intérieur. Elle agit comme une fuite perpétuelle devant l’appel de Dieu, maintenant l’homme dans une superficialité qui ne comble jamais son désir d’infini.
Conversion : se tourner vers l’intérieur
En opposition à la diversion, la conversion (con-vertere), qui signifie « se retourner, changer de direction », invite l’homme à revenir à lui-même et à Dieu. Ce concept rejoint le grec μετάνοια (metanoia), qui signifie « changement d’esprit » ou « transformation intérieure » ou encore « changement de direction ». Là où la diversion éloigne, la conversion recentre. Elle exige une prise de conscience de sa dépendance à Dieu et un mouvement intérieur vers Lui.
Le Nouveau Testament illustre cette idée dans Luc 15:7 : « Je vous le dis, de même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent (metanoia), que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance. » La conversion demande un changement radical : au lieu de fuir, l’homme accepte de se confronter à son vide, ouvrant ainsi la voie à une transformation spirituelle.
L’effroi devant l’absolu : de la peur à l’immensité de Dieu
Pascal écrit : « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. » (Pensées, fragment 201). Cette peur reflète l’insignifiance humaine face à l’immensité de l’univers, mais aussi une confrontation avec l’absolu, du latin ab-solutus, « délier, couper les liens ». Pour Pascal, cet absolu est Dieu, la source de liberté et de plénitude.
Cependant, cette crainte peut se transformer en espérance. L’homme, effrayé par sa petitesse, découvre dans l’immensité de Dieu une source de repos et de sens. Ce sentiment rejoint le Psaume 8 :
« Quand je contemple les cieux […] qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? » L’infini qui effraie devient ainsi un appel à la conversion et à l’abandon à Dieu. Briser ses liens et se jeter dans l’absolu de l’amour de Dieu.
Les résonances bibliques de l’ennui
Bien que le mot exact pour « ennui » ne figure pas dans le Nouveau Testament, des termes grecs en expriment des nuances significatives. Λύπη (lypē), traduit par « tristesse » ou « douleur intérieure », reflète un sentiment d’insatisfaction qui pousse à la repentance. Dans 2 Corinthiens 7:10, Paul écrit :
« Car la tristesse (lypē) selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. »
Un autre terme, Κόρος (koros), évoque la satiété ou la lassitude provoquée par un excès. Proverbes 27:7 (Septante) illustre cette idée : « L’âme rassasiée foule aux pieds le miel. » Ici, le dégoût pour ce qui est précieux traduit l’état spirituel de ceux qui cherchent sans cesse à combler leur vide par des plaisirs éphémères, mais restent insatisfaits.
L’Ancien Testament, riche en expressions de l’angoisse humaine, contient plusieurs termes décrivant des états liés à l’ennui. קוּץ (qûts), signifiant « dégoût » ou « lassitude », apparaît dans Genèse 27:46, où Rébecca déclare : « Je suis dégoûtée (qûts) de la vie à cause des filles de Heth. » רִיק (rîq), qui signifie « vide » ou « inutilité », se trouve dans Ésaïe 55:2 : « Pourquoi dépensez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas, et le produit de vos efforts pour ce qui ne rassasie pas ? » Ces termes hébreux traduisent une vérité spirituelle : seule une relation authentique avec Dieu peut remplir le vide existentiel que l’homme ressent. Ensemble, ces passages montrent que l’ennui, s’il est compris à la lumière de la foi, peut devenir une opportunité pour revenir à Dieu.
Ennui et acédie : la sagesse des Pères du désert
Les Pères du désert – ces chrétiens qui choisirent l’isolement vers le 4e siècle – ont exploré un concept proche de l’ennui : l’acédie (ἀκηδία). Décrite comme une lassitude spirituelle ou une apathie profonde, elle est qualifiée par Évagre le Pontique (ou Evagre du Nil) de « démon de midi ». L’acédie conduit à une perte de motivation pour les pratiques spirituelles et à une agitation intérieure, une forme de « à quoi bon » : à quoi bon tout ce temps passé dans l’isolement du désert ?
Cependant, pour les Pères, cette épreuve qui conduit à douter de Dieu, de soi-même et de la vie spirituelle, peut devenir une étape de transformation profonde si l’on persévère dans la fidélité et l’espérance. En traversant ce désert intérieur, l’homme apprend à aimer Dieu non par sentiment, mais par un acte de volonté, ouvrant la voie à une paix intérieure et à une joie ineffable. Cette lutte spirituelle rejoint les réflexions de Pascal : l’ennui, affronté avec courage, peut conduire à une véritable rencontre avec Dieu.
Rachetons le mot « ennui »
- Partager une vision nouvelle : Aidons les autres à comprendre que l’ennui peut être une voie vers la plénitude.
- L’ennui comme une opportunité : Acceptons le vide intérieur comme un espace de réflexion et de recherche de sens.
- Revoir le vide comme un appel : Considérons l’ennui non comme une malédiction, mais comme une invitation à la profondeur.
- Pratiquer le recueillement : Le silence et la prière transforment l’ennui en un temps de rencontre avec Dieu.
- Simplifier sa vie : Réduisons les distractions pour nous concentrer sur ce qui est essentiel.
Aller plus loin :
- Traité de la prière (Evagre du Nil, moine disciple de Jean Chrystostome, 4e siècle)
- La lutte contre les tentations (Evagre du Nil)
- Ermites et ordres monastiques (Le pèlerinage douloureux de l’Eglise fidèle)
- Les Pensées de Pascal (édition de 1671, regard.eu.org)
- Le Jansénisme (Société des Amis de Port Royal)